| |
Le parc et le château
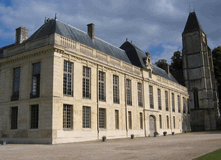 |
De la bâtisse fortifiée du Moyen-Age subsiste une voûte sur croisée d'ogives du XIII ème siècle.
L'architecture des façades date, quant à elle, du début du XVIIIème siècle.
Le château a appartenu à la famille Ségur-Lamoignon jusqu'en mars 1976, puis au syndicat de Eaux d'Ile de France jusqu'en 1986.
A cette date, Vivendi (Compagnie Générale des Eaux à l'époque) fait l'acquisition du domaine.
Organisé autour d'une cour centrale, le château a été édifié progressivement jusqu'au XVII ème siècle.
C'est à la deuxième partie de la Renaissance que l'on doit l'actuelle cour d'honneur du château. |
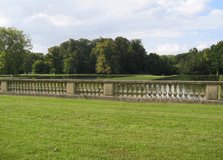
|
Propriété des d'Orgemont jusqu'à la fin du 16ème siècle, le château acquière sa superbe ordonnance au 17ème et 18ème siècles, les illustres propriétaires qui se succédent restaurent les façades Renaissance, remanient l'architecture, créent des jardins. La demeure traverse sans dommage la révolution, perd tranquillement de son prestige et les cartes postales du début du siècle montrent un château aux allures de villégiature familiale.
Au VIIe siècle, Méry n’est qu’une immense forêt de chênes et de châtaigniers appartenant à l’Abbaye de Saint Denis.
En 862, le nom de Méry apparaît sous la forme latine « madriacus », du latin «materia », qui signifie bois de construction et «ac », lieu, déformé en madéria, madria, madrier, merrain. «Merrain» désigne à cette époque soit le chêne, soit le châtaignier, utilisé tous deux pour la fabrication des douelles de tonneaux.
En 1100, Madriacus devient Mercium, Meriacum, puis Mairi au XIIIe siècle.
Au moment de la Guerre de Cent ans le domaine passe aux mains de Pierre d’Orgemont qui y fait construire en 1375, une maison de campagne dont demeure une salle voûtée à pilier central. Il y reçoit Charles V, dont il est l’exécuteur testamentaire.
Les guerres de religion de la fin du XVIe siècle entraîneront la ruine et l’abandon du domaine de Méry.
En 1583, Claude d’Orgemont, descendant de Pierre, remet le château au goût du jour par d’importants travaux.
En 1597, Guillemette d’Orgemont épouse le Comte Antoine de Saint Chamans. Il fait modifier et rebâtir l’aile Sud et en partie l’aile Ouest, aménage une première galerie et fait décorer de fresque la pièce voûtée du rez-de-chaussée. Rallié à Henri IV après son abjuration, Antoine reçoit souvent le Bon Roi à Méry. Il fait décorer la salle de chasse par une représentation de Diane et de Vénus qui illustrent les charmes de deux sœurs, Gabrielle, maîtresse de Henri IV et Angélique d’Estrées abbesse de Maubuisson courtisée par Antoine de Saint Chamans puis par le Bon Roi. Aujourd’hui encore, dans la zone industrielle de Saint-Ouen-l’Aumône qui s’étend sur une partie de l’ancien domaine de Maubuisson, un lieu porte encore le nom de Vert Galant, rappelant l’endroit où Henri IV venait rencontrer ces dames...
A la fin du XVIIe siècle, François de Saint-Chamans puis sa veuve, font modifier le décor des façades et la grande galerie conférant au château son aspect classique. Chargé par Louis XIV de conduire Marie-Louise d’Orléans en Espagne, où elle doit épouser Charles II, François de Saint Chamans s’éprend de la jeune fille et est condamné à se retirer sur ses terres de Méry. Une sanction royale adoucie par la transformation du comté de Méry en marquisat en 1695.
Le Château est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et le domaine est classé. Confiée à Jean-Michel Wilmotte, la restauration du château est effectuée entre 1996 et 1999.
En février 2004, La ville de Méry se porte alors acquéreur du château et du parc de 27 hectares, pour un montant de 9,2 millions d’euros, avec le soutien de la Région et du Département et des Espaces Verts.
|
|